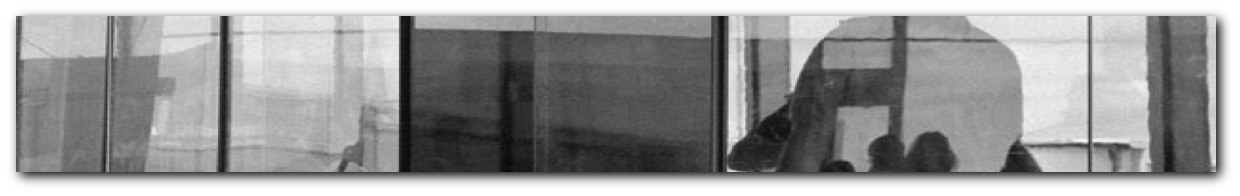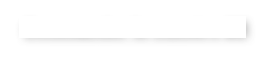
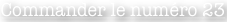
Alain Fleischer
Les Angles morts
Fiction & Cie
Seuil
"Comment le monde peut-il continuer", ainsi commence le roman d'Alain Fleischer. Dans cette première question s'entendra surtout une autre question comment peut-on écrire sur un monde détruit par la barbarie. Comment évoquer la disparition des Juifs de Hongrie et d'Europe centrale. Ont-ils à jamais disparu, ou tels des spectres hantent-ils un autre monde à côté du monde visible, dans un angle mort ?
L'énumération (thème cher à Fleischer) est ici liée à des collections d'objets ayant un mécanisme, objets ayant servi et laissés pour compte, abandonnés à leur destin de machine inerte sans utilité. Mais la collection principale, puisque le narrateur est un collectionneur, suscitant le plus de descriptions est celle de voitures. Collection loin d'être innocente. La dernière acquisition, une Daimler Light Straight, sera à la fois un fil conducteur du récit et le lieu d'une métaphore, un moyen aussi de visiter la plaine hongroise, de parcourir des angles morts.
L'argument du roman de Fleischer est apparemment simple : le narrateur Mor Steinberg revient en Hongrie pour fêter le 30e anniversaire de son baccalauréat passé en 1943, retrouvant à cette occasion ses camarades de classe et le clan des Stein, Jakub, Tibor (jumeau de Gabor), et sa nièce Gabriela, jeune fille ayant le même visage que sa mère Judit morte prématurément après l'accouchement.
Fête durant laquelle Jakub Lebenstein prononce un discours philosophique sur les catégories de la destruction. Des catégories de la destruction nous retiendrons la dernière, celle faite par les hommes, leur volonté de détruire, et, en l'occurrence, parmi les génocides du XXe siècle, celui du peuple juif d'Europe centrale, anéanti par les nazis.
Jakub propose à l'ancien clan des Stein de venir dans sa tanya (une ferme) dans la campagne hongroise. Voyage qui en cachera un autre, car dans le roman d'Alain Fleischer le récit semble être fondé sur un code à déchiffrer (d'où l'importance des chiffres, nous y reviendrons), s'inscrivant sous la figure tutélaire du dédoublement et de la dualité : Tibor jumeau de Gabor, Gabriela à l'image de Judit, monde visible détruit/monde invisible vivant. Le voyage à travers les steppes de l'Europe centrale sera aussi un voyage d'initiation sexuelle pour la jeune Gabriela qui est une figure dédoublée de Judit, femme dont le narrateur fut amoureux.
La voiture de collection Daimler est le moyen de tracer une transversale en reliant des espaces, certes, différents mais aussi tous les temps - le passé, le présent, le futur-, une traversée de l'espace-temps donc, depuis l'origine de cette voiture, (elle a appartenu à un riche juif de Bohême), ayant échappé à la destruction par un subterfuge étonnant, elle fut hissée sous le toit d'une synagogue, jusqu'à sa résurrection présente en étant utilisée. Voiture devenue non seulement le moyen de dessiner une transversale espace-temps, mais aussi une métaphore tout court. Objet gigogne recelant le testament philosophique de son propriétaire, écrit en yiddish, sur la métaphore de la conduite automobile et humaine, voiture initiatique révélant d'autres objets qui représenteront le son et l'image, dans cette quête d'un monde disparu seulement visible dans un angle mort.
Un angle mort est une portion d'espace aveugle. Le narrateur explorera "ces pliures du temps qui, formant des angles morts, nous dérobent ce dont le temps a permis l'apparente destruction, la disparition dans l'espace visible"; "Parfois des phénomènes optiques inexplicables (...) permettent de retrouver, dans la brièveté d'un instant, émergeant à la surface de notre perception consciente, la preuve que ce qui est réputé détruit ou inaccessible n'est pas invisible à jamais, mais mis en attente de la reconstruction d'un point de vue..." Et Les Angles morts précisément est la quête de ce point de vue, avec l'apparition de spectres, la sensation d'être dans un film passé, sensation que. "depuis que l'homme a appris à reproduire mécaniquement l'empreinte de son corps, ce n'est plus seulement l'espèce qui peut se reproduire, c'est le temps qui la porte et qui se plie en accordéon, et chaque pliure est l'axe autour duquel tout peut revenir et se retrouver".
Comment écrire sur un monde détruit par la barbarie ? Fleischer a choisi de nous rendre sensible la disparition (titre bien connu d'un roman de Perec, où le "e" manquant" est le "eux", ceux-là mêmes qui ont été exterminés) par l'utilisation du savoir de cette culture juive : référence à la numérologie d'inspiration cabalistique teintant tout le récit, le 33 et le 7 entre autres; articulation du récit sur des spéculations théoriques reprenant la constitution d'un dialogue avec arguments et contre-arguments, tels qu'ils apparaissent dans le dialogue des Maîtres dans la Tora, le Mahloquet (voir à ce sujet Ouaknine, Lire aux éclats).
A travers la souplesse d'une phrase ample, accumulant précisions et détails, à la façon d'un collectionneur essayant de capter le plus de réalité possible, Alain Fleischer, et c'est l'une de ses réussites, a su parler d'une souffrance absolue en la métabolisant par le jeu du langage.
Philippe Barrot
Jean Echenoz
Au piano
Minuit
Un roman d'Echenoz, c'est toujours un immense plaisir de lecture, entre désinvolture, ironie et virtuosité. On n'échappe pas à ce plaisir avec son dernier roman Au piano. Sans doute le livre le moins optimiste d'Echenoz, interrogeant la pratique d'un art, et l'ascèse qu'il impose, ici, la musique, et de manière plus générale le travail de l'artiste.
Au Piano dessine le périple d'un personnage dont l'existence, même réduite à l'état de fantôme, est dédiée à la musique. De fait dès la première page le destin de Max, un pianiste virtuose, est scellé : il mourra vingt-deux jours plus tard. Au trac sans limites et seulement limité par l'absorption d'alcool, Max, à l'approche d'un récital, "paraissait ne regarder rien d'autre que l'intérieur terrorisé de lui-même", redoutant l'instant de se mettre au piano : "le terrible Steinway, avec son large clavier blanc prêt à te dévorer, ce monstrueux dentier qui va te broyer de tout son ivoire et tout son émail, il t'attend pour te déchiqueter". Mais une fois au piano, dès que c'est à Max de jouer "tout va mieux", jusqu'à subjuguer son auditoire.
C'est en trois parties que ce destin de pianiste va se jouer. Trois parties comme la représentation du Paradis, du Purgatoire et de l'Enfer. Qu'importe la disparition par assassinat de Max il reviendra sur Terre pour jouer une nouvelle partition.
A la différence de Je m'en vais ou des Grandes blondes, où les personnages assumaient différentes aventures du récit, ici le narrateur est sur un point fixe : Max. C'est de ce seul point de vue du héros que le roman est raconté. Nous suivrons donc Max au plus près, pas à pas. Narration en forme d'étau retirant au personnage toute marge de manoeuvre, un resserrement de sa vie elle-même réduite à la pratique d'un art. En effet tout semble disparaître et se dissoudre au contact de la musique.
Les amours de Max sont inexistants, entre souvenir et apparence, des amours rêvés. Rêve d'un souvenir, celui de Rose entrevue au moment de ses études au Conservatoire. "Max passe une partie de sa vie à croire, espérer, attendre de la rencontrer par hasard. Il n'est pas une journée sans qu'il y pense quelques secondes." Ou Max rêve d'une femme entraperçue près de son domicile, "cet être inaccessible était ainsi une variation sur le thème de Rose, une répétition de ce motif".
Reste l'impression d'une vie désincarnée, prise dans la routine du quotidien, décrite souvent au conditionnel, comme si ce temps déterminait un éternel retour, une inéluctable répétition sans surprise. En revanche le retour sur terre sera plus mouvementé et le fantôme plus sensible aux besoins de l'organisme, y compris à l'endroit des femmes, ce fantôme sera pourvu d'une vie sexuelle.
L'autre personnage majeur du roman, y compris dans l'espace intermédiaire du Purgatoire où s'effectue le tri des âmes, c'est Paris. Un Paris ville-monde. Lieu majeur, omniprésent, Paris relie les espaces mentaux de l'incarnation et de la désincarnation pour faire du voyage de Max un voyage circulaire. Les déplacements intra-muros ressemblent à des voyages aux antipodes (du 18e au 16, c'est la Nouvelle-Zélande). Une capitale cosmopolite de prostituées venant du monde entier (égrenant un alexandrin parfait "c'est 15 euros la pipe et 30 euros l'amour). Ou une capitale de restaurants de tous les horizons.
Paris est aussi représenté par une topographie transversale. Le remarquable déplacement de Max -l'un des très beaux passages du roman-, qui emprunte la ligne de métro aérienne Etoile-Nation, poursuivant l'ombre de Rose, entre les stations aériennes, personnage en suspension, puis disparaissant dans les souterrains. Au-delà de la jonction de quartiers riches et pauvres, le métro aérien oscille entre incarnation (la vie des appartements que l'on voit depuis la rame) et descente aux enfers, comme si Max devenait Orphée en quête d'Eurydice.
Et en effet n'y aurait-il pas en arrière-plan, à l'état de traces, des fragments du mythe ensemençant le roman d'Echenoz, par des références altérées, diminuées ou perverties, entre Max maître de la musique, la femme disparue Rose-Eurydice ou un chien, petit Cerbère, regardant l'âme de Max s'envoler ou d'une Doris Day-Perséphone séduite au Centre de tri.
Pourquoi ce retour sur Terre? Sur un fond de mélancolie et de dépression, ce roman ne peut rester qu'en suspens, irrésolu, variation de jazz, à la manière de Thelonious Monk, sur les thèmes de la disparition, de l'abandon et du temps consacré à un art.
Finalement l'examen de conscience de Max n'aurait révélé que des péchés véniels. Max s'insurge de la condamnation au retour et d'être qu'un fantôme. "Cela me paraît injuste. Avec la vie que j'ai menée, toute au service de l'art, je pensais pouvoir prétendre à plus d'indulgence". Le guide de l'autre monde, Béliard, personnage familier des lecteurs d'Echenoz, personnage récurrent depuis les Grandes blondes où il jouait l'ange gardien de Gloire Abgrall, ce guide irascible et dépressif dicte les nouvelles lois : "Vous n'allez plus pouvoir faire l'artiste comme avant, voyez-vous, il va falloir exercer un vrai métier. "
Philippe Barrot
Umberto Eco
La mystérieuse flamme de la reine Loana
roman illustré
Grasset
Par le biais d'un narrateur amnésique suite à un accident cérébral, Umberto Eco inscrit son cinquième roman, La mystérieuse flamme de la reine Loana, dans la thématique de l'enfance et la remémoration d'une époque, l'Italie fasciste des années 30. En cherchant à renouer avec le fil biographique de Yambo Bodoni, le narrateur, affleure l'impression qu'Umberto Eco n'a jamais été aussi près de sa propre histoire, jusqu'aux images accompagnant le texte dont certaines sont des montages de l'auteur lui-même. Ce qui n'est pas sans rappeler ce qu'avait confié Eco lors d'un entretien, l'écriture à l'âge de dix ans d'un " roman " d'une trentaine de pages " Au nom du calendrier ", illustré par ses soins.
Agé d'une soixantaine d'années, Bodoni découvre peu à peu son contexte familial et professionnel, sa femme, Paola, ses enfants, son métier, libraire antiquaire, et Sibilla, son assistante, sans ressentir d'investissement affectif. Il semble être pris dans " un gris laiteux ", une brume désaffectée, l'éloignant de ses proches. Il ne reste à Bodoni qu'une mémoire sémantique, publique, en opposition à une mémoire privée, elle, disparue. " Je n'arrive à rien dire qui vienne du coeur. Je n'ai pas de sentiments, je n'ai que des dits mémorables. " Que soient loués les romanciers, les amnésiques sont heureusement bavards ! Après le tourbillon encyclopédique du début, avec entre autres un ensemble de citations sur le brouillard, métaphore constante qui traverse le roman et traduit l'ensevelissement du héros dans le non-souvenir, le narrateur tente de retrouver son histoire en s'installant à Solara, la maison de l'enfance, à la recherche de son capital affectif. Il se " lance à la reconquête de (s)on état civil ".
Ce sera l'exploration d'une mémoire de papiers et d'une atmosphère de sonorités. La structure de la maison de Solara fonctionne comme un moyen mémotechnique, portant en elle, au grenier en particulier, la substance d'une époque, les années 30 et 40, sous forme de collections : objets, timbres, revues, livres à foison, disques... Bodoni analyse les éléments découverts comme les signes culturels d'un moment de l'Histoire. En faisant de ce passé son présent, il refait l'apprentissage d'une sensibilité à la fois personnelle et collective. " Ce que j'avais découvert était ce que j'avais lu, mais comme tant l'autres l'avaient lu aussi... je n'avais pas revécu mon enfance mais celle d'une génération. "
Dans ces documents retrouvés, apparaît un clivage entre une propagande officielle, façonnée par l'image du héros guerrier prêt à la mort pour le Duce, et une formation de l'émotionnel, mais aussi d'une conscience politique, liée à une "paralittérature", bandes dessinées - Le Fantôme, Flash Gordon, Mandrake-, romans populaires - Fantômas, Rocambole, Salgari. Eco précise à propos de Mandrake " Il est clair que dans ces albums pleins de faute de grammaire je rencontrais des héros différents de ceux qui m'avaient été proposés par la culture officiellle, et c'est peut-être dans ces vignettes aux couleurs vulgaires (mais tellement hypnotiques!) que j'avais été initié à une vision différente du Bien et du Mal ". Bodoni entend (au sens propre) cette même coupure entre fanatisme fasciste et vie quotidienne dans la teneur sonore de l'époque par l'audition de vieux 78 tours, contraste des hymnes fascistes et des chansonnettes populaires (dont les textes sont retranscrits).
Cette quête de mémoire affective rencontre, bien sûr, la figure d'un éternel féminin, qui s'élabore à travers des revues Art Déco, livres ou bandes dessinées. " Je devais m'être sûrement formé, à travers une telle quantité d'images qui m'avaient ravi, une figure idéale bien à moi, et si j'avais pu avoir devant les yeux tous les visages de femmes que j'avais aimées, j'aurais pu en tirer un profil archétype, une Idée jamais atteinte mais poursuivie durant toute la vie. " Hypothèse d'un homme qui n'a pas réussi encore à accéder au coeur de sa mémoire émotionnelle. Un éclaircissement percera ce brouillard avec l'apparition du titre d'un album " la mystérieuse flamme... ".
C'est là une des raisons de l'utilisation d'un amnésique, moteur narratif qui permet de jouer sur la mise à distance de soi, parfois une critique sarcastique à l'égard, par exemple, de poèmes retrouvés, dédiés à une jeune fille, et vécus comme une poussée acnéique de l'adolescence. Est-ce la répudiation d'un moi ancien ou la lente réappropriation de soi en faisant du souvenir un instant du présent ? L'amnésie, bien évidemment, est un moyen de tendre le roman vers une révélation - il y a là une hypothèse à formuler, un rapprochement de structure de récit entre Sylvie de Gérard de Nerval (qui a tant fasciné Eco, voir à ce sujet son essai De la litérature), et La mystérieuse flamme...
Pourquoi le narrateur entrevoit une cassure intérieure à une dizaine d'années en relisant une composition imprégnée du propagandisme ambiant et la rédaction d'une espèce de chronique réaliste ? Comment est-il passé de l'embrigadement officiel à une distance critique en moins de neuf mois ? Et quel souvenir emprisonne un Vallon, toujours pris dans le brouillard, près de la maison de Solara ?
Réussissant avec La mystérieuse flamme de la reine Loana à rendre vivant ce qui a construit l'imaginaire d'une génération, Umberto Eco avoue aussi "Je ne suis jamais sorti des livres".
Philippe Barrot
Marcello Fois
Nulla
Fayard
Quelques repères sur Marcello Fois. Né en 1960, en Sardaigne, il a obtenu avec son premier roman, Pieta (1992), le prix Calvino, et a l'ambitieux projet de raconter sa ville natale Nuoro, sur la durée d'un siècle, à travers un cycle romanesque composé de six tétralogies, soit vingt-quatre romans, à teneur policière, dont Sempre caro, Sang du ciel ou Un silence de fer, sont déjà publiés et traduits en français (1).
En privilégiant comme instrument narratif le roman noir pour explorer la réalité sociale italienne, Marcello Fois a eu un dénominateur commun avec plusieurs romanciers vivant, comme lui, à Bologne et c'est ainsi que s'est créé le Groupe 13 dont l'acte fondateur fut la publication de l'anthologie : Les crimes du groupe 13 (1998) (2) avec, entre autres, Carlo Lucarelli (auteur de Phalange armée, Guernica ou plus récemment Carte blanche), Loriano Macchiavelli et Gianni Materazzo.
Nulla est un récit qui n'appartient pas directement à la fresque romanesque sur Nuoro, quoique Nulla soit le nom d'une petite ville sarde et mette en scène la même particularité insulaire, revendiquée par Marcello Fois : "ma "sardité" est ce qui me permet de me sentir citoyen du monde".
Le sous-titre de Nulla en explicite la structure narrative : Une espèce de Spoon River. En effet se référant à Une anthologie de Spoon River d'Edgar Lee Masters, publiée vers 1915 - ensemble de poèmes ayant pour thème les épitaphes d'un cimetière, et à travers elles chaque habitant racontant sa propre histoire -, Marcello Fois révèle la tonalité de ces quinze courts récits composant Nulla, chacun d'entre eux précédé d'une exergue puis d'un âge. Ce seront pour la plupart des voix d'outre-tombe, des suicidés, qui parleront revenant sur leur acte et sur l'enchaînement des faits qui les ont menés à cette fin tragique. Ce seront également des parents ou des témoins décrivant leur point de vue.
La ville de Nulla est un monde à elle seule. "A Nulla, il existe deux époques, deux âges reconnus : l'enfance et la maturité. Pour le reste, c'est l'errance." "A Nulla, il y a des divinités tellement inaccessibles qu'un bras de mer semble mesurer des années-lumière." Univers étanche, prisonnier de la médisance et de l'envie, où toute initiative semble vouée à l'échec "Pas moyen de faire quoi que ce soit ici. Trop d'envieux." "A Nulla, certaines propensions existent après coup, quand on revient, si on est arrivé à les imposer ailleurs. "
Entre l'adolescent mal dans sa peau et l'homme endetté, la rupture amoureuse, quoique chaque récit joue sur une palette de styles différents (succession, par exemple, de phrases courtes sans verbes ou, ailleurs, accumulation de parce que), chaque fois ce sont des mots simples, des phrases acérées, des descriptifs comme une lame de rasoir, qui dessinent les raisons d'un suicide. Mais le regard de Fois est sans complaisance : "...un emprisonnement que vous n'avez pas choisi, et que cependant vous avez entretenu, geôliers de vous-mêmes, plus cruels, plus inhumains que n'importe quel geôlier..."
Marcello Fois excelle à faire ressentir ces instants de pesanteur, de désespoir traduisant au plus près l'enfermement d'une insularité soumise aux jalousies et à la tradition, "parce que la terre pèse, ralentit les pas et on préférerait être né en vol ou sur la mer, n'importe où, mais pas à Nulla".
1. Aux éditions du Seuil.
2. Chez Tram'Editions.
3. Série noire, Gallimard.
Marcello Fois
Ce que nous savons depuis toujours
Dura Madre
Seuil
Marcello Fois, originaire de Sardaigne, vivant à Bologne, se définit comme un écrivain "glocal", addition de global et de local. Le "local" c'est sa ville natale Nuoro ; le "global" c'est l'universel de pulsions archaïques au coeur de nos sociétés apparemment si policées. Poursuivant l'ambitieux projet de raconter Nuoro, à travers un cycle romanesque composé de six tétralogies, en utilisant le genre policier, Marcello Fois avec Dura Madre nous immerge dans une barbarie contemporaine. L'exergue de Giono "Toute cette barbarie n'était pas seulement dans le sommeil rouge d'Angelo" donne le la à tout le roman.
De fait fraîchement arrivé du continent le commissaire Angelo Sanuti comprendra assez rapidement que son approche rationnelle d'une enquête sur un assassinat n'est pas de mise à Nuoro. La découverte sur un chantier du cadavre de Michele Marongiu suscite de nombreuses énigmes : aucune trace de balles alors que sa veste est trouée comme une écumoire, elle est couverte de sang mais le corps ne porte aucune marque de blessures par balle. Pour ajouter de la confusion à la scène du meurtre, le lieu où repose le corps porte un nom : échec-et-mort. Voilà ce qui ne peut être qu'"un signal", une signification cachée. "Echec-et-mort se rapporte à l'impossibilité de répondre, quand une chose est tellement évidente qu'elle vous laisse coi : échec et mort, justement. "
Les trois frères Marongiu semblent être au centre de l'intrigue. Ettore s'est suicidé, Raffaele est un petit délinquant et Michele vient d'être assassiné. Mais comme le précise à Sanuti le juge Salvatore Corona, natif de Sardaigne : "C'est à vous de me croire cette fois, car je m'y connais dans ce domaine. L'équilibre des familles repose sur des secrets qu'il vaut mieux ne pas dévoiler."
Et à Nuoro les histoires de famille s'entremêlent, révélant des histoires d'un sadisme achevé. Construit comme une mosaïque, en n'excluant pas des adresses au lecteur, le récit multiplie les points de vue, les retours dans le passé. Un passé où s'accumulent dettes de sang, règlements de compte, un passé qui, par touches successives, vient déterminer le présent. Un présent illisible où s'entrecroisent faillite sociale, urbanisme délirant, embrouilles financières, héritages de la haine et agissements d'un groupuscule "Cosmo Good" qui espère "Créer le chaos, le regarder grandir, les obliger à ne se fier qu'à ce qu'ils écrivent et remettent de leur propre main..." en troublant la nouvelle toute-puissance des ordinateurs par le sabotage des bases de données.
"Telle était la sensation, avoir affaire à un tas de troncs cylindriques qui roulaient les uns sur les autres. Une pile de bûches instables, rassemblées sans logique par une main hâtive (...) Une histoire à la fois ancienne et récente. Une histoire de restes. Faite de couches. Une histoire qu'on ne peut raconter", tente d'expliquer le juge Salvatore.
Ce que nous savons depuis toujours explore les "couches" d'une histoire labyrinthique, les strates -au sens géologique- de secrets menant comme une mécanique de tragédie antique à l'inexorable. Un assassinat en cache un autre ou en annonce d'autres.
Marcello Fois ne se contente pas de réussir à déployer une intrigue, il sait évoquer la poésie d'une terre sarde prise par le vent et le soleil, une terre aussi prisonnière de ses démons qu'il avait déjà décrits dans Nulla : "Des nains à l'esprit nain. A la fierté fragile, sommairement accrochée, pleins d'envie à l'égard de ceux qui ne sont pas des nains. "
Philippe Barrot
Gilbert Lascault
Cartes à jouer et réussites
Bayard
Les objets fascinent, ils sont fascinants; les objets racontent des histoires, parfois l'Histoire. Sur eux se coagule ce qui de prime abord n'est pas immédiatement lisible : les divers sous-entendus d'un inconscient collectif, les mythologies oubliées, les entrelacs d'un sens caché. Se saisir d'un objet c'est tirer le fil d'Ariane d'associations où une forêt de symboles va émerger, tout un pan de la langue se dénouer, une imagerie se révéler. Ce qui était invisible ou illisible au premier coup d'oeil devient un réseau inattendu de significations; le langage des objets n'attend qu'une seule chose : être éveillé, raconté, décrit, expliqué. L'objet-microcosme (un monde en soi) exprime là au mieux le macrocosme. Et les collections du même genre d'objets plus que jamais accumulent ces différentes strates de sens. Collections de poupées, de timbres ou de paquets de cigarettes, en disent long sur les affects de notre monde quotidien. Les objets sont, donc, de puissantes mécaniques narratives.
Dans le bel opus de Gilbert Lascault, il sera question d'explorer une "esthétique localisée (qui) multiplie des micros-légendes en une kyrielle de petits mythes, de souvenirs d'enfance, de lectures, de fantasmes et de rêves à partir des icônes cartonnées et leurs manipulations". En somme les cartes à jouer (le simple jeu apparemment de 54 cartes, et le jeu plus complexe du tarot) seront mis en scène, associés à de nombreuses références historiques, littéraires et picturales.
De quel fil se saisir pour un voyage à travers les cartes ? D'abord figures, couleurs et nombres. Ensuite, leur signification, leur symbolisme protéiforme. Gilbert Lascault rappelle les éruditions d'un jésuite du XVIIe siècle, Claude François Menestrier, sur l'art héraldique et l'interprétation des "Rois" : les quatre monarchies traditionnelles David, Alexandre, César, Charlemagne. Les couleurs résument l'ordre social : Pique des guerriers, Carreau des marchands, Coeur du clergé, Trèfle des paysans.
Chaque époque a produit ses imageries, la Révolution a remplacé l'ordre ancien par des valeurs révolutionnaires ; les rois sont devenus : La Fontaine, Voltaire, Molière et Rousseau ; les reines ont disparu, bien sûr, pour céder la place aux Libertés : liberté du culte, du mariage, de la presse, des professions. Ces anciennes reines seront, en 1886, des emblèmes patriotiques : la République, Jeanne d'Arc, l'Alsace et la Lorraine.
Les surréalistes auront leur interprétation des 54 cartes, le Jeu de Marseille, dessiné, entre autres, par André Breton, Victor Brauner, Max Ernst, Wifredo Lam ; génie, mages et sirènes balaieront rois, dames et valets, les figures dominantes seront Hegel, Freud, Pancho Villa, Alice,... et le Joker Ubu Roi.
Le chapitre consacré aux Tarots, à examiner avec "prudence et précaution" souligne Gilbert Lascault (une épaisse littérature ésotérique fait remonter le dessin des atouts majeurs, les 22 lames, à la religion égyptienne), décrit la richesse foisonnante de ces représentations qui ont fasciné Jean Paulhan.
Les arcanes majeures du tarot par le choix des allégories, leur arrangement symbolique, incitent à la narration. Raoul Ruiz s'en est inspiré pour son film : Combat d'amour en songe. Italo Calvino a écrit à partir d'un tirage de tarots Le Château des destins croisés ; des tarots Calvino a tiré "des suggestions, des associations, pour les interpréter selon une iconologie imaginaire".
Gilbert Lascault poursuit son voyage en citant les peintres qui ont mis en scène la représentation de ce divertissement : Paul Cézanne, Fernand Léger, ou Balthus qui montre " à plusieurs reprises des joueurs de cartes, adolescents, inquiétants".
L'incontournable figure du tricheur viendra ici brouiller les cartes mais pas l'esprit de Gilbert Lascault qui raconte avec érudition et précision l'éventail des diverses incarnations des cartes, il nous livre là une belle rêverie sur ces figures de l'imaginaire.
Philippe Barrot
J. M. G. Le Clézio
Cœur brûle et autres romances
Gallimard
Pervenche et Clémence, les deux sœurs héroïnes de " Cœur brûle ", première longue nouvelle qui donne son titre au recueil, ont des destins opposés, mais exemplaires du thème récurrent du livre : quelle inflexion intérieure, quelles conséquences aura l'ancrage émotionnel de l'enfance ?
De fait Cœur brûle tourne autour d'un même centre de gravité, le noyau pétri des émotions de l'enfance déterminant le comportement de l'adulte - principalement des femmes ou des jeunes filles. Le Clézio met en scène soit le manque de ce point d'ancrage affectif comme dans " Cœur brûle " ou " Kalima ", soit sa quête dans " Chercher l'aventure ", soit sa découverte dans le dernier récit " Trésor ".
Peu à peu se révèle la vie de Pervenche qui habite la mémoire de sa sœur Clémence à travers une photographie de la rue des Tulipanes, rue d'une ville mexicaine où elles vécurent une partie de leur enfance : " Clémence n'avait pas oublié ce temps-là, elle y replongeait à chaque instant comme dans un rêve interrompu. [...] Elle est tout à coup très loin de son bureau de juge, elle sort de son corps et elle se retrouve là-bas, sur une autre planète, comme dans un grand jardin que ni elle ni Pervenche n'auraient jamais dû quitter. " Si Clémence a su s'intégrer dans le monde des adultes, Pervenche, elle, s'y perd. Et le récit nous décrit le glissement progressif de Pervenche, chute reprise en miroir par les scènes se déroulant dans le cabinet du juge des enfants, Clémence, qui est face à la violence, interrogatoire d'une petite prostituée de quinze ans, victime " des quartiers chauds ", victime de " l'emprise des hommes, leur dictature, leur persuasion pour faire le mal ".
Histoire dédoublée, histoire de Pervenche vendue par Laurent " son ami " avec beaucoup de guillemets qui " l'a amenée où il voulait, dans cette pinède, il l'a trahie, vendue. Il s'est servi d'elle comme d'un animal. Elle pense cela sans horreur, parce qu'elle est maintenant tout à fait au fond du gouffre ".
Gouffre du masochisme de la survie. En effet dans une posture archaïque (souvent elle replie les jambes sur son corps, retrouvant sur un sol nu une position fœtale, glissant " dans un trou profond et sombre. Ou plutôt c'était son vieux rêve d'un boyau perforant la terre dans lequel elle rampait "), Pervenche répète cet abandon au désir du plus fort pour obtenir de l'autre une proximité minimale, une attention que sa mère, Hélène, était incapable de lui donner, un monstre d'égoïsme qui " faisait fluctuer la vie de ses enfants au gré de ses amours successifs ".
De même la nouvelle " Kalima " écrite sur le mode de l'apostrophe, commençant par le descriptif d'un corps dans une morgue, se construit autour de la femme vendue et prostituée. Jeune femme venue de Tanger à Marseille, seule au monde, il ne restera de sa mémoire émotionnelle que " les piqûres des flocons sur tes joues, sur tes paupières. [...] Plus jamais tu n'as ressenti cela: être jeune, libre, découvrir la neige ". Femme sans ville ni pays, prise dans la violence du déracinement, coupée de son univers, possédant juste " des papiers, des permis de séjour, des cartes, des quittances " avant sa disparition.
Les textes " Hôtel de la Solitude " ou " Chercher l'aventure " atténuent cette noirceur de l'innocence face au mal, faisant entrer le lecteur dans un monde nostalgique ou projectif. La femme d'" Hôtel de la solitude " ayant vécu toute sa vie dans des hôtels n'est riche que de ses souvenirs ; elle se remémore le temps écoulé et le bain émotionnel du dehors, " elle aimait disposer dans une soucoupe un fruit, une pomme, qu'elle regardait jour après jour vieillir et se friper comme un visage de femme ". Au contraire du temps passé, " Chercher l'aventure " ouvre le récit sur un temps à venir, sur tous les possibles. Une jeune fille de quinze ans marche dans une ville, prompte à découvrir l'inattendu, l'étincelle du hasard, avec ce thème récurrent de la difficulté d'être dans le monde des adultes. Ne sachant pas où s'ouvre le " portique de la nuit ", elle poursuit sa quête le long d'une ville se creusant " comme une grande vague qui déferle ". Elle cherche dans les yeux " qui croisent son regard quelque chose, une exaltation ". Regard qui s'associe au regard d'Alice dans " Les trois aventurières ", elle a conservé dans ses yeux l'éclat de la vie, sachant " discerner la beauté surnaturelle dans les vanités du monde et ne se détourne jamais de la pauvreté inguérissable de la race humaine ".
Le dernier récit " Trésor " semble être une réponse au livre lui-même, une forme de délivrance. En Iraq, près de Pétra, paysage de désert rouge, Samaweyn, héros de " Trésor ", ne possède qu'une valise noire, donnée par son père disparu, valise pleine de secrets et de trésors, en réalité des photographies et des papiers jaunis, la mémoire de son père. Répondant aux empreintes archaïques de l'enfance, aux blessures qu'elle inflige, la réflexion achevant " Trésor " aurait-elle l'intonation de la voix de Le Clézio lui-même, après la quête des Édens, des paradis perdus :
" Aujourd'hui j'ai quitté l'incertitude de l'enfance et je marche jusqu'à ma mort sur la même route, comme doivent le faire les hommes. "
Philippe Barrot
J. M. G. Le Clézio
L'Africain
coll. Traits et portraits
Mercure de France
L'Africain dépasse à peine les cent pages et dans ce bref espace papier illustré de photos (provenant des archives personnelles de l'auteur), Le Clézio parcourt un grand espace mental et géographique, exploration d'une mémoire sensorielle et narration autobiographique sur ses origines. En 1948, à huit ans, Le Clézio part avec mère et frère retrouvé au Nigeria son père médecin. Ce sera une double rencontre, une double initiation, celle d'un pays où règnent le corps et la nature et celle d'un ordre paternel.
Déjà présente dans Onitsha sous forme de fiction, la découverte de l'Afrique est représentée dans L'Africain comme expérience intime "C'est ici, dans ce décor, que j'ai vécu les moments de ma vie sauvage, libre, presque dangereuse. Une liberté de mouvement, de pensée et d'émotion que je n'ai plus jamais connu ensuite." Un réservoir de sensations, où l'enfant n'est pas pris par l'imposture des mots "usés", un Eden d'avant la nomination des choses, Le Clézio a ressenti l'immensité et la puissance d'un monde "dénué de mensonge". La liberté du corps, l'impression d'être happé par la plaine ondulante devant la maison qu'ils habitaient. La nature s'impose avec sa violence, "ouverte, réelle qui faisait vibrer mon corps". Le Clézio décrit "la part la plus logique de [s]a vie", profondément ancrée dans une nature échappant à la coupe réglée de la civilisation.
L'arrivée en Afrique, c'est aussi (et surtout) la rencontre avec un père que la guerre avait séparé de sa famille, isolée à Nice. Le père est vécu comme un étranger, un inconnu qui prématurément vieilli par vingt ans d'exercice en Afrique dans des conditions difficiles ("Il faisait tout de l'accouchement à l'autopsie") ordonnera la vie familiale autour d'une discipline inflexible, rupture avec le monde niçois de l'enfant roi. A l'opposé de la fantaisie et du charme de la mère, une dureté paternelle qu'interroge précisément Le Clézio, et pourquoi ce père parti en Afrique ? D'origine mauricienne, ayant fait ses études de médecine en Angleterre, par orgueil et goût de l'aventure, l'esprit rebelle, il décide de rompre avec la société enropéenne et d'être médecin des colonies, son premier poste l'amène en Guyane anglaise, une préparation à l'Afrique où il s'installe en 1928. Amoureux de ce continent, il y restera jusqu'à sa retraite.
Insérées dans le corps du texte des photos prises par le père de Le Clézio ponctuent l'itinéraire africain, le racontent, de la carte d'un territoire où les distances sont écrites en heures de marche, à la Baie de Victoria, photos faites avec un Leica à soufflet, où se lisent l'abandon, la solitude, "l'impression d'avoir touché la rive la plus lointaine du monde".
Cet amour de l'Afrique n'est pas sans ambivalence. Le temps de la guerre dessine une ligne de fracture. Avant, le moment de l'aventure et du mariage, l'ivresse de la vie physique. Le Clézio rappelle ce que les Africains ont coutume de dire "les humains ne naissent pas du jour où ils sortent du ventre de leur mère, mais du lieu et de l'instant où ils sont conçus". Une belle rêverie des origines où Le Clézio introspectif se sent relié à la mémoire de l'Afrique. Durant la guerre, le père de Le Clézio est coupé des siens dans l'impossibilité de les rejoindre, il devient prisonnier d'une territoire qu'il essaie de fuir en vain.
Avec pudeur, dans un lyrime tendu Le Clézio nous donne le portrait d'un père qui aura "dépassé la mesure d'une vie", brisé par la guerre, et d'une Afrique où "les jours d'Ogoja étaient devenus mon trésor, le passé lumineux que je ne pouvais pas perdre."
Philippe Barrot
Le lecteur-inventeur
Avec le slogan, "A bas Laforgue, Vive Rimbaud", il y a, bien sûr, la proposition d'un programme de lecture et le dessein d'un nouveau paysage. Les Surréalistes puisque le mot d'ordre fut d'eux redistribuaient les cartes de l'histoire littéraire. Rimbaud devenu archétype du poète, le Poète même à son degré absolu.
Le lecteur se fait là inventeur, au sens le plus strict du terme. Et André Breton ne fut pas avare d'inventions, Lautréamont au premier chef, et une grille de lecture jetée sur la littérature.
Le passé littéraire constitué par des références stabilisées à travers des manuels est pris à revers, change de cap, en somme le passé est mouvant. La lecture a ce pouvoir d'y instiller un mouvement perpétuel, selon la capacité d'un lecteur à précisément inventer un auteur disparu des étagères, des mémoires, ou reclus dans l'enfer des bibliothèques, ou en déshérence quelque part au fond d'un tiroir. L'inverse est aussi vrai les surréalistes ont dévalué Anatole France si durablement que persiste encore un préjugé à son endroit. La lecture ressemblerait à une bourse de valeurs, fonctionnant sur un mode financier (dont la référence est symbolique et non monétaire - même si le symbolique est monnayable mais c'est un autre sujet). Spécule-t-on à la hausse ou à la baisse d'un écrivain? La lecture jalonne la littérature de sursauts évaluatifs/dévaluatifs. C'est selon les modes du marché : l'air du temps, la nécessité qu'incarne un écrivain, les préoccupations qu'une époque projette dans une oeuvre... Un des mécanismes d'évaluation qu'utilise le lecteur-inventeur est le "plagiat par anticipation". Une quête d'origine, de filiation, pousse le lecteur-inventeur à chercher l'antériorité d'un écrivain. La parenté rétrospective est une création de liens, brouillant la temporalité. C'est le monologue intérieur d'Edouard Dujardin dans Les lauriers sont coupés mis en valeur par James Joyce. Dujardin existe par l'excellence de Joyce. Dans une chronologie inversée, le second écrivain invente le premier. Ce mouvement de filiation (voire d'annexion) rend surréaliste Victor Hugo avant la lettre, certains passages des Mémoires d'Outre-Tombe proustiens...
Cette quête d'origine a partie lié au cycle consommation-production, lecture-écriture, on entre dans une lecture productrice qui se traduit par une intertextualité, proche en l'occurrence d'une intersexualité, cannibalisme mineur alimentant un réseau d'échos, de résonances, d'influences.
Mais de l'invention d'un écrivain à son "assassinat par enthousiasme", il n'y a qu'un pas. Le lecteur se fait tueur. L'appropriation du corps d'un texte, son dépeçage le plus sévère, voire le plus radical, appartient au lecteur-théseur. Redoutable lecteur qui ne tait rien d'un texte, il espère le faire parler par tous les moyens. L'admiration révèle là un côté absolutiste. Quelques écrivains sont les terrains de prédilection à ce genre d'exercice de style. La grandeur d'une oeuvre se mesure-t-elle à sa capacité de résistance à l'interprétation ?
Feu pale de Nabokov raconte de façon exemplaire les effets pervers d'un lecteur-traducteur-admirateur et qui au sens propre du terme finit par assassiner son auteur fétiche. C'est aussi la narration d'un "il" (celui de l'écrivain) en concurrence avec un "je" (celui du lecteur) qui semble répéter le jeu d'absorption, d'effacement, de substitution, de procuration que suscite l'acte de lire.
Philippe Barrot
Pierre Mac Orlan
Domaine de l’ombre
Phébus
Mac Orlan et le fantastique social
En 1937, Mac Orlan avait réuni dans Masques sur mesures des textes explicitant la notion de fantastique social, expression qu'il avait utilisée pour la première fois, en 1926, lors d'une conférence sur le fantastique au cinéma. A l'initiative de Francis Lacassin, Domaine de l'ombre rassemble une trentaine de chroniques de Mac Orlan publiées dans la presse entre les années 1920 et 1960, explorant différents aspects de cette thématique.
A la différence du fantastique romantique, dominé par l'intervention du surnaturel, le fantastique social se révèle, au début du XXe siècle, dans l'évolution de la société industrielle, qui manifeste un matérialisme à toute épreuve. " La cité future ne sera donc que l'agrandissement solennel d'une chambre de tortures ", annonce-t-il. Mac Orlan privilégie l'image de l'ombre pour exprimer l'apparition de pulsions primitives sur la scène sociale d'une société décomposée par le cataclysme de la Grande Guerre.
" Les paysages de l'ombre sont plus mystérieux que les paysages de la nuit. " Réservoir du fantastique, le domaine de l'ombre déploie des tourments et des inquiétudes qui se matérialisent à travers des lieux, des moments, des attitudes mentales.
Les récits comme " L'aube ", " Éléments du demi-jour ", " Nocturne " ou " Quartier réservé " traduisent ces instants et décrivent ces lieux où les gens " s'associent sans raison " vers la rue Pigalle ; une humanité de l'ombre " imperméabilisée par la misère " reconstitue une Cour des miracles. Le fantastique se tisse avec les lumières artificielles de la nuit ; ou au petit matin à la gare de l'Est quand " l'aiguille des boussoles [...] tend vers le Nord social ", les gestes quotidiens s'accomplissent dans un brouillard surpeuplé ; ou à Marseille, dans un quartier réservé aux maisons closes et aux petits bars, dominé, avant la guerre de 1914-1918, par " la bienveillance populaire ", Mac Orlan déplore qu'une " pudeur mal comprise " aboutisse à l'hypocrisie ; on finira par " Boire à huis clos, dans un placard. Aimer les femmes dans un autoclave. Fumer, la tête dans une cheminée ".
Mais ce sont surtout des attitudes mentales qui incarnent le fantastique, en particulier le retour de l'animisme.
Dans " Valets de l'ombre ", " Usages et traditions domestiques ", " Dieux de poche et talismans ", Mac Orlan montre comment se développe, avec la " disparition des religions d'origine chrétienne " de nouvelles superstitions exorcisant la peur. Durant la guerre pour maîtriser les signes annonciateurs de chance ou de malheur, les soldats créèrent " une infinité de petites religions, aux rites souvent étranges ", que la paix relégua " dans le capharnaüm intime de la pensée ". Ce sont des divinités provisoires, de petits monstres anonymes, nouveaux dieux lares siégeant au coin d'une bibliothèque. Effets de la pensée magique conjurant le mauvais œil et le coup du sort qui manifeste une " guerre sournoise et cérébrale entre la nuit et le jour ".
Dans plusieurs textes dont " Fantastique criminel ", Mac Orlan aborde un fait social apparu après la Grande Guerre : le crime en série. Ces criminels sont des fantômes " qui habitent l'ombre de notre temps ". Mac Orlan constate que le sang a perdu sa valeur, et que l'horrreur du cadavre a disparu. " L'humanité ne connaît plus ce réflexe qui avant la guerre encore la faisait se cabrer devant le sang répandu. " Avec la diffusion des moyens médiatiques - presse, radio, cinéma, photographie, les meilleurs " conducteurs " du fantastique -, l'image d'un grand crime devient " l'attrait effroyable de l'aventure criminelle " (Landru, Haarmann et le vampire de Düsseldorf).
Dans un registre différent, Mac Orlan critique les effets de la science et dénonce son pittoresque monstrueux qui " tend toujours à nous mettre en présence des hypothèses les plus raisonnables sur la fin de notre propre planète ". Avec ce périple effectué principalement à travers la mentalité de l'entre-deux-guerres, Mac Orlan souligne le rôle de la littérature romanesque, " seul agent de rapprochement et de compréhension entre les peuples " ; elle met en scène en les stigmatisant les bacilles sociaux dangereux, causes de guerre, ces " fureurs collectives provoquées par un patriotisme trop héréditaire sont souvent l'expression spontanée d'une petite sottise nationale adroitement exploitée ".
Mac Orlan en nous conviant à visiter " nos arrière-boutiques cérébrales " reste un contemporain ; le fantastique se perpétue entre nos nouveaux mythes et une notable misère sociale.
Philippe Barrot
Giorgio Manganelli
Eloge du tyran
Le promeneur
" Mais ainsi, n'avoir rien du tout à dire, déjà c'est difficile, et en plus parler de ce rien, croyez-vous que ce soit facile?" demande le personnage principal de l'Eloge du tyran. Certes, non ! Pour Giorgio Manganelli (1922-1990), qui fut romancier, essayiste, journaliste, dont les éditions du Promeneur poursuivent la publication de ses fictions, après La Nuit ou Le Marécage définitif maintenant l'Eloge du tyran, l'art de développer une situation à partir de presque rien n'est pas en soi une difficulté mais une puissante stimulation, où paradoxe, sarcasme et rhétorique se mêlent de façon qu'un récit en attente de devenir soit l'objet de toutes les remarques d'un écrivain théologien saisissant le moindre mot pour s'échapper loin de la fiction entreprise.
Le sous-titre apparemment sans ambiguïté de l'Eloge du tyran (écrit dans le seul but de gagner de l'argent) ne fait qu'ajouter une touche ironique au propos : la narration d'une situation, le face à face (ou le duel) bouffon-tyran, en d'autres termes les relations entre écrivain et éditeur, et la promesse d'une histoire.
Le bouffon (figure itérative dans l'oeuvre de Manganelli) proclame "solennellement ne prêter nulle attention ni aux idées, ni à l'utilité pour les choses", qu'il désire "être fidèle au titre de ce livre" ; le personnage de bouffon "déguisé dans la grande foule des écrivains, de ceux qui comme moi s'amusent avec les sonorités ambiguës des paroles" est face à l'autre figure, l'éditeur, qui "est de la race des princes, et qu'en conséquence s'éveille en moi la secrète vocation à me faire homme de cour". De ce bouffon il serait inutile d'attendre des idées, "choses qui lui sont tout à fait étrangères", et l'espoir d'un récit est problématique. C'est même la question de cet Eloge du tyran : aborder le moment fatidique d'un début d'histoire. De là se construit un récit tout en coupures et ruptures, en impossibilités et impasses, un labyrinthe où la rencontre bouffon-tyran est différée, jusqu'à une séance spirite, entre écrivain-médium et éditeur-fantôme.
"En tant d'éditeur tu veux une histoire d'espions"? L'interrogation assure-t-elle vraiment au lecteur qu'il y aura quelque secret développement? Manganelli préfère l'art de la digression, de la parenthèse. S'il plante un décor de romance, c'est pour mieux le détruire par l'accumulation de questions et de détails sans rapport avec le propos initial. S'il amorce le portrait d'un d'espion, ce sera pour mieux le dissoudre dans des considérations théologiques.
Par ce travail sur le négatif, l'éloignement, l'impatience du lecteur, l'attente, Manganelli joue constamment avec le désir d'histoire et d'émotion. Le vrai tyran se révèle être l'écrivain-bouffon lui-même, le maître des mots et des phrases qui dérobe continuellement une chose n'advenant que dans la narration de sa propre constitution. Et le lecteur restera sous le charme de ces bribes emboîtées, ces tentatives qui interrogent ce qu'est, finalement, la littérature.
Philippe Barrot
Henri Michaux
Œuvres complètes, tome 2,
La Pléiade, Gallimard
"...où l'on se trouve enfermé, une des impressions les plus odieuses que je puisse avoir et contre laquelle j'ai lutté ma vie durant (...) retrancher, réduire (...) au lieu de l'étalement de tous mes textes, qui à coup sûr me dégoûterait et à brève échéance me paralyserait." C'est ainsi que Michaux expliquait son refus à être publié de son vivant dans la Pléiade. Et en effet, dans ce deuxième tome des Œuvres complètes consacré aux livres de la maturité allant de 1948 à 1959, de Ailleurs, à La Vie dans les plis, Passages, Face aux verrous, Misérable miracle, L'Infini turbulent et à Paix dans les brisements, le remarquable travail de Raymond Bellour et d'Ysé Tran met à jour variantes et variations, déchiffre la genèse de livres issus de première publication en revue, montrant ainsi la mobilité d'une oeuvre toujours susceptible d'un changement, ajoutant des "En marge" à la fin de chaque oeuvre où se trouvent les textes évincés au fil des éditions ou republiant un texte interdit à la réédition comme Nous deux encore.
L'expression "me paralyserait" fait image, et traduit au plus près la crainte de Michaux : ne plus être dans la dynamique d'un mouvement et les turbulences infinies de vibrations au sens propre et au sens figuré. Il y a, d'abord, un brouillage des genres, entre journal ethnographique et journal intime, dans Ailleurs, entre fable et confession dans La Vie dans les plis, entre essai et invention de petites fictions, dans Passages, ou compte rendu quasi scientifique par la tonalité et les références dans Misérable miracle ; il existe là une manière d'écrire dans un mouvement dépassant la frontière des genres, le désir de défaire leur étanchéité. Il y a, ensuite, la volonté d'une exploration, à tout prix et par tous les moyens, des processus psychiques puisque tel serait l'objet central de Michaux, en s'épiant au plus près de lui-même -"j'écris pour me parcourir", dit-il-, et cette exploration ne cesse de découvrir, justement une fois encore la mise en mouvement de variations et de bruissements intérieurs, jusqu'aux "états vibratoires" que révéleront les expériences mescaliennes.
Sous l'apparence d'un compte rendu de voyage, dans Ailleurs, nous ne visitons pas seulement le pays des Emanglons, qui vivent dans l'angoisse, mais nous sommes surtout déplacés vers un autre lieu celui de l'imaginaire, de sa mécanique, où les événements se donnent à voir comme allant de soi, la proximité des choses tenant au naturel avec lequel la narration nous y plonge alors que le descriptif minutieux de la cruauté des Emanglons, par exemple, augmente un malaise indéfinissable face à ce qui reste "sans utopie et sans pédagogie". Comme l'a expliqué Michaux dans Passages : "Mes pays imaginaires : pour moi des sortes d'Etats-tampons, afin de ne pas souffrir de la réalité."
Et, de fait, ce lien avec la réalité mène Michaux à une exploration de la manière dont s'est constituée sa vie intérieure, cette relation entre dedans et dehors. Des visites Au pays de la magie jusqu'à Face aux verrous, sont mis en scène l'appropriation de soi et la spécificité d'une pensée circulant de l'animisme à la magie, chaque fois se posant la question de l'efficacité des mots.
Trois poèmes à la puissance incantatoire composant "Poésie pour pouvoir" ("Je rame", "A travers mers et désert", "Agir, je viens", II, Face aux verrous), qui ont été deux fois publiés dont une édition assez singulière, puisque la reliure en bois de teck avec une trentaine de clous (reproduite p. 1225) fait du livre un objet de magie, et "Pouvoirs" (Passages) sont révélateurs de cette quête d'un poème-action, interrogeant la possibilité d'interaction entre le monde de la pensée et l'extérieur par l'utilisation d'un "concentré d'énergie psychique". "Si vraiment il y a dans les mots une force efficace, si à la force intérieure du sentiment intense on peut faire prendre une direction..." ("Pouvoirs")
Février 1948. Moment de rupture, de deuil. Nous deux encore, texte dont on ne peut "s'emparer frontalement" comme le dit Raymond Bellour, est écrit à la suite de la disparition de la femme d'Henri Michaux dans un incendie. De février à mars 1948, Michaux répond à la catastrophe en produisant plus de trois cents dessins.
Composé d'un côté par "Liberté d'action" et "Apparitions", publiés avant 1948, et de l'autre par "Portrait des Meidosems" rédigé ultérieurement, le recueil La Vie dans les plis (1949) est donc divisé par cet événement tragique.
Dans "Liberté d'action" se déploie un "je" tourbillonnant, ironique et rageur, c'est l'odyssée de la "défense folle " de l'enfance, loin des voyages imaginaires, nous sommes face à une "autre vie possible et terriblement personnelle" (Bellour, 1100), quand "je circulais entre les falaises d'adultes obscurs" ("Vieillesse de Pollagoras"). On suit l'analyse de processus psychiques comme dans, entre autres, "La séance de sac" : "Il y avait un grand adulte encombrant./ Comment me venger de lui ? Je le mis dans un sac..."
A l'opposé répond la souffrance des Meidosems, le dernier peuple imaginaire dont Michaux fera le portrait, "regardant non par leurs yeux crevés, mais par le chagrin de leur perte". Si le mot "âme" est surprésent dans ce portrait, s'il semble que les Meidosems soient aériens, en apesanteur, vibratiles, d'une fluidité insaisissable, sans consistance, sujets de toutes les métamorphoses - "ils prennent la forme de liane pour s'émouvoir"-, ils sont aussi saisis de spasmes électriques, et ne savent plus "comment se tenir, comment faire face", le visage calciné "ils vivent surtout dans des camps de concentration". Ils sont voués à "un Présent sans issue". Apparaît avec les Meidosems le lien essentiel écriture-peinture, puisque la première édition fut accompagnée d'une série de lithographies faite par Michaux.
Au milieu des années 50, Michaux change d'inspiration, quittant les rivages de pays imaginaires, de fables débridées, il expérimente la mescaline, Misérable miracle et L'Infini turbulent en retracent les linéaments. Il "entre dans une tourmente hallucinogène". La tonalité volontairement appuyée de traité scientifique - l'observation d'un cas - n'empêche pas progressivement d'accéder, hors des territoires de la volonté et d'un humour destructeur, à une ouverture dépassant ses refus. "On se sentait plutôt pris et prisonnier dans un atelier du cerveau. " Un cerveau fonctionnant à une vitesse inouïe. On entre dans l'univers brouillé où "la mescaline image et réalise instantanément sensations ou idées". Un infime séisme permanent. "Le triomphe de l'abstrait". La mescaline fait des images "si exactement dépouillées... si uniquement visuelles qu'elles sont le marchepied du mental pur". Mais surtout à partir d'une "pensée expérimentale", s'entrevoit le dépassement de soi-même par l'accélération, une vitesse qui n'est plus le tempo de Michaux, hors de tout contrôle, comme changer de corps.
Erreur de dosage ou lapsus gestuel, Michaux absorbe le sextuple d'une dose, et tombe dans une "folie schizophrénique". C'est le moment d'une grande épreuve de l'esprit, imposée, il se sent réduit à une ligne, sans frontière, n'étant plus rien.
Loin de cette expérience, un moment apaisé, mystique, dans L'Infini turbulent, où Michaux voit "des milliers de dieux". Pour la première fois il éprouve un sentiment d'adhésion, d'osmose avec le monde et contemple un "élément commun à tout l'univers, le lien, le raccord et la base infiniment simple,... unissant tout, qui accomplit la continuité universelle".
Les nombreux dessins accompagnant Miséable miracle et L'Infini turbulent racontent l'autre versant de cette trajectoire pétrie par la drogue. Loin des dessins idéogrammatiques d'un langage originaire et d'une multitude de corps et de visages de Face aux verrous, se trace l'image d'un séisme, de tremblements sillonnant des pages marquées par une coupure, un sillon.
La relation de Michaux et de la peinture s'inscrit dans toutes ces oeuvres de maturité, de l'irrémédiable présence affolante de visages ("En pensant au phénomène de la peinture") aux dessins à la ressemblance d'un tracé d'électroencéphalogramme, inclus dans Misérable miracle, Michaux en se parcourant est protéiforme, et "Comme une aiguille sismographique mon attention la vie durant m'a parcouru sans me dessiner".
Philippe Barrot
NATSUME SÔSEKI
ET PUIS
Le Serpent à plumes
YUKIO MISHIMA
UNE MATINÉE D'AMOUR PUR
Gallimard
Publié en 1909, à la fin de l'époque Meiji et au moment de l'occidentalisation du Japon, Et puis retrace la vie de Daisuké, fils de famille aisée. " Et puis traiterait non plus de la naïveté de la jeunesse, mais de la perspicacité, voire de l'artifice ou même des regrets et de la résignation de l'âge adulte ", précise une note de l'éditeur, rappelant les propos de Sôseki sur son roman.
Avant d'aboutir à la résignation de l'âge adulte, au début du roman, Daisuké écoute battre son cœur, le " flux paisible de son sang chaud " et, à trente ans, il se voue à une inactivité sans concession en vivant de subsides paternels. Son but dans l'existence est de réfléchir à l'accomplissement de ses désirs. D'ailleurs " Fabriquer dès le départ un but, (...) et le plaquer sur un individu, revenait à ravir à ce dernier son action libre ". Daisuké devient le spectateur attentif de ses fluctuations intérieures évitant d'être le prisonnier d'une situation entravant sa liberté. Ce Narcisse un peu ébloui " considérait sa fragilité nerveuse comme un impôt qu'il devait acquitter en échange d'une sensibilité exacerbée et d'une puissance spéculative dotée d'une finesse unique ", remarque ironiquement Sôseki. Un Daisuké que rien ne mettrait en mouvement, un dandy loin de la vie accélérée d'un Tokyo changeant, en proie à l'ennui - le mot " ennui " revient à plusieurs reprises sous la plume de Sôseki, terme emblématique résumant la vie quotidienne d'un Daisuké ayant " à sa disposition beaucoup de temps que le travail ne souillait pas ". Esthète à l'abri des besoins matériels, mais pas des remontrances familiales sur le choix d'une activité et l'acceptation d'un mariage arrangé.
Le Japon industrialisé courant derrière les puissances européennes est la toile de fond réaliste sur laquelle se dessine l'histoire de Daisuké qui, malgré son indolence et ses évitements, devra sortir de sa vacuité " ...pour cingler ma conscience trop engourdie, il faudrait que j'agisse sur cet environnement. (...) Il songea finalement qu'il existait une voie pour le sauver de sa vie débilitée. Il articula pour lui-même "C'est sûr, il faut que je voie Michiyo". "
Michiyo est la femme d'un ami perdu de vue, Hiraoka, de retour à Tokyo. Daisuké peut regretter amèrement d'avoir contribué à l'arrangement de ce mariage, il constate la permanence d'un sentiment ignoré. Le thème de l'argent revient en scène de façon plus perfide. Naïvement Daisuké croyait rembourser les dettes du couple, moyen dont il s'est saisi pour se rapprocher de Michiyo, en demandant l'argent à son frère et à sa belle-sœur. Un refus catégorique qui plonge notre héros dans une quête à laquelle il n'est pas habitué, donnant lieu à des scènes gentiment ironiques où Sôseki multiplie les impasses. Pour la première fois Daisuké s'interroge pour savoir comment gagner de l'argent sinon sa vie. Ce n'est que le début de remises en cause plus pénibles, dont la rupture avec les valeurs de son père. En effet Daisuké comme le Japon de l'époque est à cheval sur deux mondes, l'ancien Japon et son code des samouraïs, et le nouveau occidentalisé, avec une revendication individuelle, " plutôt que des liens tissés par mes ancêtres, je préférerais une épouse avec qui je tisserais des liens personnels " estime Daisuké.
Considéré comme le premier roman psychologique de Sôseki, Et puis relate non seulement la progressive transgression par un individu de l'organisation hiérarchisée de la société, mais il fait aussi de l'argent un enjeu symbolique dépassant le cadre des relations interpersonnelles, pour rappeler que le Japon était, à l'époque, débiteur de l'Occident, critiquant en même temps la " débâcle des sentiments moraux " face à l'affairisme.
La douceur et la tonalité feutrée de Sôseki ne sont pas ce qui d'emblée apparaît à la lecture des nouvelles de Mishima réunies sous le titre Une matinée d'amour pur. Le recueil rassemble sept nouvelles publiées de 1946 à 1965. De la première écrite alors qu'il avait une vingtaine d'années jusqu'à la dernière, on est immédiatement touché par la cruauté et l'ambivalence des sentiments. Mishima nous convie à la visite d'un univers violent, des premières émotions de l'amour, de la sexualité, ou de la vengeance amoureuse (" La Lionne ", écrit d'après Médée d'Euripide). Se mesure également l'évolution du style de Mishima sur un même thème, l'amour, la première nouvelle " Une histoire sur un promontoire ", est d'une poésie lyrique alors que les suivantes sont écrites dans un style dépouillé. Le lyrisme d'" Une histoire sur un promontoire " était le moyen le plus efficace pour traduire l'émotion d'un enfant, échappé pour un instant à la surveillance parentale, qui découvre la beauté d'un paysage " chargé de mélancolie ", une promenade le sauvant " de la monotonie insupportable de l'enfance " durant laquelle il apprend " une vérité qu'on ne peut facilement transmettre aux autres ", vérité entr'aperçue en suivant dans un jeu de cache cache une jeune fille et son amant.
Ces nouvelles s'ordonnent autour de révélations, d'une face cachée des sentiments, de leur ambiguïté. Dans " Haruko ", la tante scandaleuse du narrateur était partie avec le chauffeur de la maison. Plus tard elle initie son neveu à la sexualité. Mais cette initiation n'est que le début d'échanges amoureux, que ne comprend pas tout de suite le narrateur. Haruko, une figure énigmatique, qui là aussi avec l'apparition du monde pulsionnel, réveille la vie d'un narrateur destinée à la platitude et insuffle " une nouvelle façon de vivre qui devait me menacer et me fasciner ".
Il serait vain de raconter ou d'esquisser le récit de ces nouvelles unies par un sadisme parfois mal tempéré, comme dans " Le Cirque ". La dernière nouvelle " Une matinée d'amour pur ", qui donne le titre au recueil, d'une structure plus complexe en deux parties, est d'une perversion classique. Un couple âgé vit dans le souvenir de leur amour et la femme semble ne pas avoir vieilli. Une fois épuisée leur imagination à reconstituer une scène de baiser de leur jeunesse, point symbolique de leur union, ils cherchent d'autres moyens afin de ressusciter une libido assoupie. " Leur froid mépris envers l'utilisation d'autrui servait de garantie à leur passion. " Mais cela n'est pas sans inconvénient ni danger...
Mishima excelle à décrire non sans poésie des instants de perversité où le lecteur trouvera la satisfaction de ses propres ambiguïtés.
Philippe Barrot
Franco Moretti
Atlas du roman européen 1800-1900
Seuil
"Mettre en rapport la géographie et la littérature (autrement dit dresser une carte géographique de la littérature [...]) signifie donc révéler des aspects du champ littéraire qui nous étaient restés jusqu'à présent cachés." Voilà en quels termes Franco Moretti introduit son Atlas du roman européen soulignant d'emblée le lien étroit qui unira texte et cartographie; son essai avec 91 cartes et diagrammes essaiera de répondre à la question : "Comment la géographie réussit à engendrer le roman de l'Europe moderne." Signalons que la traduction de cet ouvrage fut soutenue par le programme Ariane 1999 de la Commission européenne.
La géographie de la littérature possède deux sens opposés : soit l'espace dans la littérature, c'est-à-dire une dimension imaginaire, comme le Dublin de Joyce, le Paris de Balzac; soit la littérature dans l'espace, géographie ayant là un sens socio-culturel. De fait Moretti envisage ces deux aspects, entre l'élaboration d'un genre (le roman en l'occurrence) dans les oeuvres - entre autres - de Jane Austen, Charles Dickens et Balzac, jusqu'aux raisons de sa diffusion durant le 19ème siècle en Europe.
L'originalité de Moretti consiste à dessiner des cartes avec la matière romanesque et, à partir d'elles, d'établir un modèle de lecture. Il focalise, d'abord, son analyse sur la constitution de l'Etat-nation tel qu'il apparaît chez Jane Austen ou Walter Scott à travers les relations entre campagne, villes, frontières et colonies. Face à la "domination plus vaste, plus abstraite, plus indéchiffrable" de l'Etat-nation, le roman serait "la seule forme symbolique capable de le représenter", en devenant un moyen de domestiquer l'espace.
Sur une carte de la Grande-Bretagne Moretti constate que les intrigues des romans de Jane Austen se déploient sur la seule Angleterre. Cette réduction de l'espace met en scène un "déracinement territorial", qui explicite la mobilité sociale exigée par un Etat centralisé, anciennement fondé sur les grands domaines agricoles, se transformant en pays industriel.
Moretti insiste sur la valeur emblématique du roman historique qui traduit la même exigence de l'Etat-nation : unification, subordination à un centre, abolition des frontières régionales, fin des "châteaux gothiques des pouvoirs féodaux". Le roman véhicule cette transformation, sa langue est impersonnelle, "commune", contribuant à la construction de l'Etat par le nivellement des "barrières physiques" et des "dialectes locaux".
A cette vision générale de la fonction du roman historique ou sentimental, Moretti remarque chez Walter Scott dans Waverley une "phénoménologie de la frontière". Lieu privilégié de modification stylistique, "l'impact avec la frontière a produit un brusque déferlement de figures"; rappelant que les métaphores "sont capables à la fois d'exprimer l'inconnu qui s'ouvre devant nous et de le contenir".
L'insistance de Moretti à dire que la géographie détermine un genre littéraire s'ancre dans une argumentation historique, celle-ci constitue, sinon une contradiction, au moins une restriction à sa tentative de lier quasi organiquement cartographie et littérature. Pour appuyer sa démonstration de la prévalence d'une forme spécifique (ici le roman sentimental) en accord avec un espace donné (l'Europe au début du 19ème siècle), Moretti évacue le contenu idéologique, réfutant, à titre d'exemple, la lecture que fait Edward Saïd de Jane Austen dans Culture et impérialisme, pour y substituer une vision purement formelle inspirée de la Morphologie du conte de Wladimir Propp. L'analyse géographique semble là simplificatrice.
En revanche le lien cartographie-littérature est plus convaincant pour le roman d'inspiration coloniale (sur une carte de l'Afrique, les traits figurant la linéarité des intrigues reflètent l'unidimensionnalité du colonialisme, aller de l'intérieur vers l'extérieur du continent africain afin d'orienter son économie vers une métropole) et pour le roman urbain auquel Moretti consacre un chapitre
A partir d'une carte établie par Tooth en 1889 où est définie une topographie de Londres sur les critères de richesse et de pauvreté, on est plus à même de s'approprier le thème d'un espace signifiant quand Moretti souligne les itinéraires décrits par les silver-fork novels - roman de la haute société - opposés aux espaces où se déroulent les histoires de crimes des Newgate novels. Pour les uns le Londres du West End, pour les autres les bas-fonds. Deux Londres juxtaposés, hermétiques l'un à l'autre, deux Londres qui cohabitent sans s'interpénétrer. L'analyse cartographique prend là tout son sens. Les diagrammes sur les rencontres et les déplacements dans les romans de Dickens explicitent la tentative du romancier d'unir par ses intrigues le Londres des riches et le Londres des pauvres.
Au-delà de ce schéma oppositionnel, le Paris de Balzac est une ville, au contraire, "polycentrique", une "mosaïque de mondes". En inscrivant sur un plan de Paris les lieux d'attraction et de passage des différents personnages des Illusions perdues, Moretti démontre comment ce Paris-là est une capitale éclatée, "sans le Quartier latin et la tension qui existe entre ce quartier et la ville de Paris, nous n'aurions pas le miracle du roman de formation français".
C'est un Paris "orienté par le désir et agrégé par la rêverie", où s'exprime non plus le système binaire londonien de Dickens mais un système narratif ternaire grâce à l'introduction d'un nouvel élément, le tiers, qui "est la figure de la surdétermination sociale".
L'Atlas du roman européen s'achève sur une réflexion sociologique. La littérature dans l'espace, c'est-à-dire sa diffusion. Comment le roman est devenu un genre majeur en Europe? A cela plusieurs facteurs.
Fouillant archives et statistiques, Moretti a reconstitué une image de la lecture en Europe au 19ème siècle, à l'aide des registres de "bibliothèques circulantes" et des récapitulatifs de livres prêtés. Il constate l'expansion des livres les plus traduits et les plus lus.
L'industrialisation du livre a écarté les livres de dévotion qui ne pouvaient pas dans une Europe aux disparités religieuses, entre catholicisme du Sud et protestantisme du Nord, être représentatifs et unifiants. En fait "toute l'Europe lit les mêmes livres, avec la même opiniâtreté et (...) se reconnaît dans "l'imagination mélodramatique" : une rhétorique des teintes fortes, qui mêle l'histoire, les émotions et le mystère."
En tête des traductions Alexandre Dumas et Eugène Sue. Après la défaite de 1815, la France vaincue va gagner sur le terrain culturel ce qu'elle avait perdu sur le terrain militaire, aidée en cela par l'"autarcie victorienne" qui a réduit la Grande-Bretagne à son insularité. Avec le "roman naît en Europe un marché littéraire commun".
Quoique la conceptualisation d'une géographie déterminante et déterministe soit parfois floue, cet Atlas de Moretti est riche, foisonnant, d'une lecture attrayante, captant de nombreux éléments pour cerner au mieux les contours d'une Europe culturelle.
Philippe Barrot
Jérôme Peignot
Typoèmes
Seuil
Issu d'une famille de fondeurs typographes (la société Deberny-Peignot remontait au 19e siècle), Jérome Peignot a inscrit son oeuvre poétique dans une relation à l'écriture au sens concret du terme (avec entre autres Le Petit Peignot, Petit traité de la vignette ou Typoésie). Dans son dernier recueil, Typoémes - mot valise unissant typographie et poèmes -, l'auteur poursuit son investigation du monde des signes, donnant forme à une "poésie visuelle" qui prend le langage dans sa matérialité et qui interroge le sens de la figuration typographique de la lettre elle-même. Ici nous est donc proposé un voyage à travers éperluettes, accolades, paragraphes, chiffres, lettres, virgules, points, parenthèses, apostrophes, portée musicale,... pérégrinations à travers rosaces de lettres, alphabets croisés, palindrommes.
Jérôme Peignot explique dans un entretien : "L'écriture est née d'une obsession : véhiculer le concret. On a commencé par dessiner des images avec les pictogrammes ou les hiéroglyphes puis, peu à peu, on y a associé des sons qui ont pris le pas sur l'image, faisant passer le tout du concret à l'abstrait" et précisément Peignot a "cherché à revenir à une écriture pictographique". Avatar du calligramme la typoésie est un retour au concret contre l'abstraction du signe, une quête sur le lien entre signifiant et signifié. En quoi la forme d'une lettre recèle-t-elle un sens propre ? Quelle est la motivation d'un signe ? La poésie visuelle et concrète travaille la langue dans ce désir de retrouver ou d'accéder à l'union du sens et de la forme l'exprimant, la langue de l'Eden. "...on est en droit de se demander si l'arbitraire seul a présidé à la configuration graphique de notre langue. Plus ou moins consciemment, ceux qui l'ont forgée n'ont-ils pas cherché à ce qu'un lien graphique demeure entre le signifiant et le référent ? (...) ne serait-on pas bien inspiré de poursuivre ses investigations plus avant encore et de trouver l'étymologie graphique des êtres et des choses? " écrit Jérôme Peignot en préface de Typoèmes.
Certes s'interroger sur le lien typographie-langue, signification de la matérialité de l'écriture, ce travail dans l'espace du lisible/visible, remonte loin dans l'histoire de l'écrit et semble répéter la quête de sens que suscite l'énigme de la distribution des espaces blancs et des paragraphes dans les textes sacrés, en particulier tels qu'ils apparaissent dans le texte hébreu de la Genèse. La mosaique des blancs dans une page typographiée du Coup de dés... de Mallarmé porterait-elle une signification théologique (voir à ce sujet Meschonnic)?
Au-delà du jeu des espaces blancs dans l'écriture, par quels moyens Jérôme Peignot parvient-il " à un nouveau matin du siginifié" ? Une des méthodes consiste à revenir aux locutions pour être au coeur du concret. Un exemple parmi tant d'autres Le typoème "Comment nier que mon pays compte beaucoup ? " Paysage de montagnes dessiné de chiffres jusqu'aux cimes et aux nuages que résume le signe de l'infini par la masse imposante d'un 8 couché en travers de la page.
Jérôme Peignot ne se livre pas à un jeu formel, il délivre les formes d'un sens qui échappe au premierr regard, à l'inattention du lecteur, à l'habitude de ne pas voir dans les lettres qu'un dessin dénué de signification en soi.
Philippe Barrot
Francis Ponge
Œuvres complètes, tome II
La Pléiade
Gallimard
" Je réfléchis aujourd'hui que d'une façon générale je n'écris que pour ma consolation (...) et que, plus le désespoir est grand, plus la fixation sur l'objet (on le nomme en linguistique le référent) est intense (...) comme si tout en dépendait (tout, c'est-à-dire ma vie même et de là, tout le reste : le monde (la nature) entièr(e). " Réflexion-bilan écrite en 1968, dans La Table, Ponge avait presque soixante-dix ans. Et précisément le degré d'intensité (de fixation sur l'objet) déterminera l'extrême exigence de l'écrivain dans ses capacités à le dire : "Notre âme est transitive. Il lui faut un objet, qui l'affecte, comme son complément direct, aussitôt". Objet devenu la parole elle-même.
Le second tome des oeuvres complètes couvre la période des livres publiés depuis 1965 allant jusqu'au Nouveau nouveau recueil, on y trouvera, entre autres, Le Savon, La Fabrique du pré, L'Atelier contemporain, Comment une figue de paroles et pourquoi, et un foisonnement de textes publiés hors recueils, des entretiens, et l'habituel apparat critique de la Pléiade avec des notices éclairantes, sans oublier le travail de transcription des variantes, ici particulièrement riches.
Pour un Malherbe ouvre ce second tome et développe ce que Ponge avait esquissé dans La Rage de l'expression ("publier l'histoire complète de sa recherche, le journal de son exploration"), donnant ainsi toute son ampleur à une exploration textuelle qui mène à une impossibilité d'aboutir, faite de reprises et de répétitions initiant une véritable écriture contrapuntique. Ainsi la fin de Pour un Malherbe est constituée par une variation quasi musicale sur une introduction.
Malherbe chez qui Ponge admire la mécanique d'une "horloge grave, robuste, sérieuse". Malherbe : "C'est le mouvement perpétuel." Ponge est loin des effusions sentimentales, d'un laisser aller à l'inspiration, et son ambition est de produire "une machine de paroles" qui nous fraye un itinéraire à travers la "patrie du monde muet", le monde des objets, le seul capable d'apporter une "consolation matérialiste". Ponge écrit contre le "magma analogique", contre la "Démagogie des images" et semble poursuivre le développement d'une "rectification perpétuelle", comme une ramification végétale, un jeu d'additions textuelles traduisant au plus près un ruminement, de façon à "atteindre la réalité dans son propre monde, le monde des textes". D'où la nécessité de mettre les mots sous surveillance, de chercher leur sens premier, l'outil le plus à même de surveiller les mots étant le Littré dans cette quête de l'étymologie, manière aussi de se protéger contre les mots venus spontanément. Ponge ne rappelle-t-il pas qu'il avait abandonné durant plusieurs années la rédaction de La figue..., en raison de la première phrase apparue automatiquement "La figue est molle et rare." Pourquoi ce "rare"?
Mais la quête d'étymologie est aussi, bien sûr, une quête des origines. La volonté d'assoir les mots sur un sens "immuable", retrouver le moment de leur première nomination, relève d'une rêverie édenique. Ponge ne dit-il pas dans un entretien : plonger à l'intérieur de la langue, "aller à la langue mère, le latin (...), et ensuite le grec, jusqu'aux racines védiques" ; et aller à l'endroit de la langue où elle ne fait qu'un avec les choses, afin de mordre en elles, de les assimiler "et obtenir d'elles leur mystère".
Du Savon, à La Fabrique du pré à Comment une figue de paroles et pourquoi, l'exploration pongienne n'est pas séparée de répétitions, de reprises "...ces répétitions, ces reprises da capo, ces variations sur un même thème, ces compositions en forme de fugue... pourquoi nous seraient-elles, en matière littéraire, interdites?" "C'est ainsi, après tout, que je travaille, c'est ainsi que naissent en moi les développements, c'est ainsi que l'esprit progresse" (extrait de la deuxième conférence du Savon)
La place particulière du Savon dans l'oeuvre de Ponge tient au fait qu'il se constitue et se présente comme livre au contraire d'autres textes repris en recueil, qui feront l'objet de ces fameux dossiers publiés ici in extenso (comme Le Pré ou La Figue). Le Savon tente d'épuiser tous les dispositifs textuels, conférence, poème, journal, saynète, momon (Littré : " espèce de danses exécutée par des masques"), par la progression là aussi d'une écriture contrapuntique, qui utilise un large éventail des formes pour dire l'objet.
Ne pourrait-on pas étendre ce désir "d'épuisement", comme Perec avait tenté "l'épuisement d'un lieu", aux dossiers La Fabrique du pré et Comment une figue de paroles...?
Ponge ici pousse au plus loin la logique de la révélation du processus de l'écriture en train de se faire, il met "sur la table les états successifs de [s]on travail d'écriture". Dépassant l'adjonction d'atelier où se donnent à lire quelques brouillons ou repentirs, il déploiera l'ensemble d'avant-textes, livrera toutes ses premières versions. Le lecteur entre en somme dans les coulisses de l'écriture, il est associé à ce dévoilement, à cette visite dans l'intimité. Ponge montre le caché (ce qui chez d'autres écrivains relèvent du secret de fabrication, du hors champ du texte), révèle au contraire un amont du texte qui en perpétue le devenir. Il précisera à propos de Comment une figue... "... j'ai résolu d'exposer, une bonne fois, à longueur de pages, et, cette fois, sans la moindre retenue, tout le nombre de feuillets qu'il m'avait fallu gâter pour mener à son achèvement (je veux dire à son efficacité), quoi donc ? Quelle espèce d'ouvrage?"
Achèvement? Il y aurait beaucoup à dire sur le titre d'un livre publié en 1984, Pratiques d'écriture ou l'inachèvement perpétuel. Travail perpétuel puisque les rédactions de Pour un Malherbe ou de La figue s'étendent sur une vingtaine d'années. En effet, Ponge ne cesse de différer l'achèvement ou de le mettre en perspective pour montrer que l'essentiel n'est peut-être pas l'objet-texte clos mais réside dans le mouvement du travail. Un chantier en devenir comme chez les peintres. Picasso lui parle de faire, non une oeuvre mais des exercices. De fait dans L'Atelier contemporain, où sont célébrés peintres et sculpteurs, comme Braque, Fautrier, Germaine Richier, Giacometti., une image court ces textes, le monde est transporté chez les artistes pour être réparé, "l'homme en souci de l'homme".
Rappelons que Ponge s'intéressa aux expériences les plus contemporaines, et y participa, estimant que "l'amour des Anciens" n'empêche pas son appartenance à l'avant-garde. Ainsi dans les années 60 il fut associé au début de Tel Quel (ayant admiration pour Philippe Sollers et Denis Roche). Associons-nous à son invitation et parcourons cette oeuvre protéiforme : "Lecteur je t'invite à lire l'écriture de la lecture de ce que j'écris."
Philippe Barrot
Atiq Rahimi
Terre et cendres
P.O.L
Roman court, une centaine de pages à peine, Terre et cendres, traduit " de cette langue persane, communément appelée le dari, pratiquée depuis les temps anciens en Afghanistan ", comme le précise la préface, immerge le lecteur dès les premières lignes dans une atmosphère d'attente douloureuse. Le récit déploie une scène unique, au moment de l'invasion russe de l'Afghanistan. Au bord d'un pont surplombant une rivière asséchée, près d'une piste de terre où veille un gardien dans sa guérite, un homme, Dastaguir, accompagné de Yassin, son petit-fils de cinq ans, guette l'arrivée d'une voiture pour aller à la mine où travaille son fils, Mourad.
Dans ce décor de montagnes, simplifié à l'extrême, l'attente est ponctuée par les souvenirs de Dastaguir et les demandes à boire et à manger de Yassin... ce sont plutôt des cris, en effet il est sourd. " Le monde de Yassin est devenu un autre monde. Un monde muet. Il n'était pas sourd. Il l'est devenu... ". Les tympans crevés suite au bombardement par les Russes du village où il habitait.
Cherchant de l'eau, Dastaguir établit un dialogue précaire avec le marchand d'une échoppe de l'autre côté du pont, moment de dialogue où l'évocation du village massacré se dit peu à peu. La douleur " soit elle arrive à fondre et à s'écouler par les yeux, soit elle devient tranchante comme une lame et jaillit de la bouche, soit elle se transforme en bombe à l'intérieur, une bombe qui explose un beau jour et qui te fait exploser...". Tandis qu' " un camion rompt le sommeil pesant de la poussière ", Dastaguir sait que pour pouvoir à nouveau dormir, il faudrait " être comme un nouveau-né ", sans aucune image, sans aucun souvenir.
La narration de Terre et cendres est faite par un " tu " décrivant les gestes et les pensées de Dastaguir; un " tu " qui est en même temps une adresse au lecteur, l'associant de façon intime aux reviviscences du personnage. A cette forme narrative, s'ajoute le dépouillement de la phrase, il n'y a presque pas de subordonnées. Une fois le livre fermé, on a l'impression d'une voix obsédante qui continue à parler comme une prière.
Philippe Barrot
Rezvani
Fous d'échecs
Actes Sud
En s'intéressant à la dramaturgie qui entoure la compétition échiquéenne de haut niveau, Rezvani nous plonge dans une mythologie du pouvoir donc de la violence.
Le descriptif n'aura pas ici droit de cité. L'auteur prend la "résolution de ne pas succomber aux plaisirs de la description rétinienne". Notre imaginaire serait entré "en désimagination par excès d'images". Fou d'échecs se déploie sous forme de dialogues, foisonnements de récits emboîtés où chaque personnage tient sa partition, nerveuse, tendue, au même titre qu'une pièce sur un échiquier. Un roman fait en cercles concentriques où le héros n'est jamais vu ni entendu: il est raconté.
D'emblée s'installe l'atmosphère paranoïaque d'un championnat d'échecs où naviguent des figures emblématiques: un Champion universel, invisible, son Entraîneur, un Parapsychologue, chez qui une violente souffrance - la mort de sa femme et de sa fille dans un incendie- a provoqué des dons médiumniques, un Biochimiste, un Major, personnage trouble d'une police échiquéenne... Les amateurs d'échecs reconnaîtront par bribes, nourrissant le roman, des allusions aux épisodes d'un championnat mondial entre Kortchnoï et Karpov, instants de guerre froide entre un dissident et un orthodoxe; ailleurs, l'histoire d'un certain Kasparov...
Pourquoi le Champion universel est-il près de renoncer à la compétition? De quelle lutte de pouvoir est-il l'enjeu?
Le champion est victime d'une prise d'otage sur l'aéroport d'Ankara par un fou qui a une seule exigence: changer le jeu des échecs en abolissant l'échec et mat. Sortir du pouvoir, cette éternelle dialectique du dominant-dominé. Après son assassinat par les tireurs d'élite du Major, à l'instigation de la Mère du champion, un monde s'écroule. Une mécanique s'est déréglée. Le champion ne veut plus jouer. Ce fou, un ancien grand maître, l'avait initié aux échecs, quand il était enfant, en traçant sur le jardin d'un hôpital d'aliénés un échiquier imaginaire... hôpital baptisé le Château (domaine en effet kafkaïen) et dirigé par le père du Champion, qui a pour initiale K.; un nom dont le champion dut se défaire, pour complaire à une Fédération toute-puissante, prenant le nom de la Mère.
Cette éviction paternelle signe la première victoire du pouvoir maternel, la reine noire qui domine toutes les activités de son fils, créant une dépendance du "fils-Roi" à l'égard d'une "Reine-mère esclave", le programmant psychiquement par l'invention de faux souvenirs. Elle va jusqu'à imaginer que son fils-Champion fut conçu contre les hommes: il porterait en lui "les deux compléments solaires de l'androgynie", une manière de sortir de la reproduction sexuée par la parthénogenèse. Le mythe de l'androgyne, une réponse à la redistribution des rôles et des pouvoirs entre hommes et femmes, une autre forme d'abolition de l'échec et mat, la reproduction à l'identique, conquête non pas d'espace sur un damier mais du temps par l'immortalité.
A cette figure folle de la reine noire, s'oppose la reine blanche, Wanda, l'inventivité même, championne universelle virtuelle. C'est la seule avec qui le champion entretienne un lien de spontanéité; la seule avec qui il découvre l'extrême intelligence de combinaisons échiquéennes belles comme des diamants inaccessibles au commun des joueurs. Une Wanda toujours allongée sur un lit, au corps indéfini, sans limites, entourée de chats et d'échiquiers. Une Wanda, inspiratrice.
Avec Wanda, la reine blanche, l'écrivain, témoin de tous ces duels, arpente les lois régissant les échecs, qui seraient "l'exemple probant d'une histoire fossile de l'humanité" où la reine avait tous les pouvoirs dans la réalité; souveraineté archaïque de la femme; une image de femme essentielle voguant entre Erycina, Aphrodite, Urania et Athéna, tandis que le roi représentait l'homme "d'avant le déni obsessif de la féminité".
Au-delà de cette mise en scène de la répartition des pouvoirs entre féminin et masculin et d'un "théâtre où se joue la tragédie oedipienne", Rezvani ne cesse d'interroger notre force de symbolisation à travers les mythes pour ne pas succomber à un "esprit d'astuce", producteur de machines. Manière pour Rezvani d'enfoncer le clou dans le ventre des carnassiers sociaux, nourris au lait d'un libéralisme morbide.
Le roman ne s'achève pas avec le matage du Champion par la reine noire; il rebondit encore. "Chaque livre se joue pour moi comme une partie dont les propositions s'enchevêtrent et se compliquent à tel point qu'il pourrait ne jamais aboutir à sa fin... " Nous voilà pris dans un labyrinthe enchanté, l'entrelacs des péripéties n'en finissant pas de renverser les perspectives.
Philippe Barrot
Natsume Sôseki
Le mineur
Le Serpent à Plumes
Publié en 1908, Le Mineur se situe dans la période la plus féconde de Sôseki ; de 1905 jusqu'à sa mort en 1916, il a produit ses principaux chefs-d'oeuvre. Dans Théorie de la littérature, Sôseki écrit : " Je me console à l'idée que cette neurasthénie qui a engendré la folie m'a permis d'écrire Je suis un chat, de publier Entre le ciel et la terre, de faire connaître au public La Cage aux cailles, et le seul sentiment que j'éprouve est une reconnaissance profonde et infinie envers cette déraison. " Quoique Le Mineur n'appartienne pas à la catégorie de ses oeuvres à caractère autobiographique, il semble cerner au plus près ce que Sôseki appelle sa neurasthénie.
Un narrateur somnambulique, qui restera jusqu'au bout sans identité, marche dans la banlieue de Tokyo, ayant l'impression de s'ensevelir dans un monde trouble et brouillé. Une marche " à l'intérieur d'une angoisse qui ne se dissiperait pas, tant que durerait ma vie ". Sur un coup de tête un fils de famille, âgé de dix-neuf ans fait une fugue, décidé, semble-t-il, à se suicider au plus vite. Il veut se rendre à la cascade de Kegon, lieu bucolique au centre du Japon pour mettre en scène un suicide hautain et aristocratique. Mais un rabatteur, Chozo, au bord de route le détourne de ce projet pour le faire engager comme mineur, lui promettant beaucoup d'argent. Ce " je " inconsistant qui désirait " s'enfoncer dans le noir " estime que sur le chemin de l'autodestruction la mine serait un bel accomplissement. Après avoir pris le train, commence le périple jusqu'à la mine, " à l'intérieur de l'intérieur des montagnes ", une longue marche à travers un paysage sans couleur. Le Mineur est la narration d'une lente dégradation, sur le chemin escarpé d'une oscillation entre vie et non-vie.
Comme une fugue le roman tisse thème et contre-thème, autour du personnage central qui, au-delà du narrateur, est le temps lui-même. Tout le récit s'inscrit dans la perspective de celui à qui est arrivé cette histoire, un moi de l'époque des faits étranger au moi présent qui raconte de façon lacunaire l'aventure. Comme un récit à double face, le chemin menant à la promesse d'une autodestruction montre l'avènement d'une introspection. Face à l'inconsistance du moi initial se dresse la densité d'un moi réflexif, ironique et acerbe.
Du romantisme d'un suicide imaginé, on passe à l'apprentissage progressif de l'inacceptable - les humiliations incessantes du guide Chozo, les moqueries sans fin des mineurs. Si le narrateur se complaît à penser qu'il reste pour " unique consolation d'avancer avec la mort comme but ", il constatera de façon amère que même lorsque " l'âme erre de la sorte, au moindre appel, le naturel revient au galop ". Le corps le rappelle à la réalité. Le grand dessein du suicide se dissipe avec les premières crampes de la faim.
En feuilletant un moi très ancien sur lequel " manier mon bistouri sans vergogne, dans l'espoir d'examiner les moindres de mes émotions que je dissèque minutieusement ", le narrateur découvre une vie intérieure et ce qu'est l'homme, éprouvant qu'il est " ondoyant et mêlé ", variable, versatile, " comme l'eau qui fuit, le coeur se transforme et s'évapore à l'instant ". Déchoir jusqu'à la mine est l'expérience nécessaire pour n'être plus le prisonnier d'une routine, et comprendre que " mon coeur était chose éternellement changeante ". Cet itinéraire-là lui révèle le " mécanisme vital des transformations mentales permettant [l'] introspection ".
A l'arrivée dans la ville minière, il constate une réduction du langage ; les mineurs n'ayant plus le temps de questionner le sens des mots, ils parlent un langage d'une extrême simplicité. Il remarque également que leurs visages sont identiques, ressemblant presque à des bêtes.
Le narrateur s'enfonce dans la déchéance, une descente aux Enfers. La régression psychologique et physique aboutit à une exploration labyrinthique de la mine, ultime chute de l'humain qui s'est déshumanisé. Perdu au fond de la mine, prisonnier d'un dédale de couloirs, se pose de façon ultime son désir de vie ou de mort. Dans un état d'épuisement la vanité sauvera le narrateur qui ne veut pas mourir dans le sordide, Sôseki mesurant là, avec sarcasme, le grand écart de la mort à la vie.
Roman d'une analyse quasi clinique des fluctuations intérieures, Le Mineur élabore un manque à être ; cette pauvreté à laquelle le narrateur croyait échapper mais en regardant le visage des mineurs laminés de fatigue il constate qu'il est comme eux, sans signification.
D'une grande modernité en s'interrogeant sur le roman lui-même, Sôseki, avec Le Mineur, dépassant le roman métaphorique sur la condition humaine, donne à vivre, comme Kafka ou Beckett, un sentiment de cruauté et de déréliction.
Philippe Barrot
Pablo de Santis
La traduction
Métailié
Avec ce premier roman traduit de l'argentin, Pablo de Santis utilise une trame policière pour explorer la thématique de la traduction et voyager à travers le langage jusqu'aux langues mythiques, soulignant que " l'écrivain se traduit lui-même, comme s'il s'agissait d'un autre, le traducteur écrit l'autre, comme s'il s'agissait de lui-même ".
Angoissé migraineux, à tendance obsessionnelle, Miguel de Blast, le narrateur, traducteur de textes scientifiques, accepte l'invitation de Julio Kuhn, ancien condisciple d'université, à un congrès de traducteurs organisé à Port-au-Sphinx - le Sphinx, animal de la mythologie vaincu par l'intelligence et la sagacité, signe annonciateur de ce que sera le récit, une suite d'énigmes.
Les congressistes s'installent à l'Hotel internacional del faro, partie d'un vaste complexe touristique désert, disproportionné comparé à la taille de la station balnéaire. Un étrange hôtel à moitié construit.
Miguel de Blast nous livre, d'abord, un portrait rapidement esquissé des participants : Valner, spécialiste de la langue énochienne, telle que les anges l'ont transmise à John Dee; Rina Agri et Zúniga, complices de Valner dans l'intérêt pour les langues inventées, perdues ou artificielles; Vázquez traducteur de romans policiers; Naum, un absent attendu avec impatience et Ana Despina, une ancienne liaison. La rencontre avec Ana est décevante, toute complicité a disparu, leur conversation se résumant en un "malaise de plus en plus palpable". Puis le congrès commence.
Le récit conjuguera avec virtuosité et humour le thème de la traduction, un paradigme du rapport à la langue étrangère, dans sa singulière étrangeté parfois inaccessible.
Le syndrome de l'écho, objet de la première intervention du congrès, avait atteint une professionnelle de la traduction simultanée : " Chaque fois qu'elle entendait un mot elle ne pouvait s'empêcher de le traduire. " Comment guérir cet écho envahissant son espace intérieur? Verdict d'un ingénieur et d'un neurologue : " Il faut voyager dans le temps. Le sujet doit remonter jusqu'à l'époque où les choses et les mots coïncidaient, quand il n'y avait qu'une seule façon de tout dire, avant la démolition de la tour de Babel. "
L'analyse d'Ana sur la traduction anglaise - fausse ou réelle - d'un manuscrit attribué à Nietzsche met en scène le même questionnement sur ce qu'il y a derrière un texte, derrière une langue. Ana conclut que le manuscrit est une vraie traduction d'un original faux. En effet, la " traduction charrie toujours des sédiments de la langue qui se trouve au-dessous [...] la langue de la traduction est impossible à imiter ".
La présentation d'un cas clinique par Blanes, un psychiatre, montre comment un ancien aphasique (ayant le même prénom - Miguel - que le narrateur) avait entrepris des traductions imaginaires. Ce Miguel trouvait un sens à tout, ne supportant pas qu'une signification reste obscure, incapable de dire : je ne comprends pas. " Son refus de ne pas comprendre laissait un goût amer d'absence de sens, car tout comprendre était exactement la même chose que ne rien comprendre. " Or à la fin de la conférence, Zúniga, personnage fantomatique, prononce quelques mots dans une langue que personne n'avait jamais entendue, langue proche du grec de l'Attique. A l'audition de ces mots incompréhensibles, Miguel devient fou, ayant trouvé un sens qui n'existait pour personne d'autre.
Sous des facettes différentes, chaque partie du récit s'interroge, au-delà de la langue originale d'un texte à traduire, sur une langue des origines, une mythologie de la première langue articulant la trame policière du roman. De fait, entre ces séminaires qui se poursuivent imperturbablement, les meurtres s'accumulent.
Valner est découvert mort au fond de la piscine vide dans la partie en construction de l'hôtel (une construction impossible, semblable à une traduction qui ne prend jamais fin), comme plus tard, Rina Agri sera trouvée morte dans sa baignoire, une pièce de monnaie sous la langue.
L'OuLiPo avait recensé le nombre de coupables possibles dans un roman policier, jusqu'à une catégorie de coupable impossible : le lecteur lui-même. De Santis apporte-t-il un démenti à ce dénombrement, inventant une nouvelle sorte de coupable?
Philippe Barrot
Index et archives de recensions publiées dans La Quinzaine littéraire de Philippe Barrot